Du 21 au 25 novembre dernier avait lieu comme chaque année la Semaine de la Sécurité des Patients, une initiative menée par le Ministère de la Santé et de la prévention dont l’objectif est « d’interpeller l’ensemble des publics potentiellement concernés par ce sujet crucial. Et ainsi, favoriser un dialogue entre usagers, patients voire résidents et professionnels de santé et médico-sociaux, mais aussi entre professionnels ».
Si l’on peut saluer de telles intentions, cette semaine thématique n’est que trop rarement l’occasion pour les instances médicales de mettre les usager.ères au cœur de leurs préoccupations. Or, nous affirmons qu’une relation médecin-patient, en particulier en gynécologie-obstétrique, doit être une construction commune, se gardant de penser à la place de mais bien en écoutant ce que chacune des parties a à dire.
Des cultures médicales antithétiques
Pour certain.es, sécuriser les naissances consiste à les concentrer dans de vastes centres hospitaliers, où la proximité des équipements est à même de permettre une prise en charge rapide le cas échéant. Ce parti-pris consiste à considérer la grossesse et l’accouchement comme potentiellement à risque et à privilégier une approche techniciste. Des protocoles sont appliqués pour tenter d’anticiper la pathologie et la régler aussitôt. L’inconvénient d’un protocole se révèle lorsque celui-ci devient routinier et s’applique sans distinction envers toutes et tous, entraînant une augmentation progressive de gestes potentiellement invasifs tels que la rupture artificielle des membranes, l’injection d’ocytocine de synthèse en cours de travail, qui provoquent leur lot de conséquences sur la mère et l’enfant. D’ailleurs, Le Monde pointait ce 30 novembre dans un article intitulé « En obstétrique, un événement sur deux est évitable » les dysfonctionnements des services dédiés à la naissance.
Pour d’autres, dont nous sommes, l’essentiel du soin n’est pas la pathologie mais la relation : pouvoir adapter les procédures à un corps singulier et un mode de vie donné, sans renoncer au soin mais en considérant que la personne qui le reçoit doit décider pour elle-même du traitement qu’elle accepte. En somme, rien d’autre que ce qui est inscrit dans la loi Kouchner de 2002. Un telle approche ne nie pas l’existence de la pathologie ni des accidents, elle s’efforce de les prévenir et de les remettre à leur juste place dans une approche prophylactique.
Face à ces deux visions parfois opposées de la médecine, celle du cure et celle du care, la meilleure façon d’entrer en relation nous paraît être non pas le mépris mais le dialogue, un dialogue véritable toutefois, dans lequel les deux parties, médecins et usagères sont à égalité puisque c’est bien du corps des usagères dont il s’agit et qui constitue leur domaine d’expertise. Un dialogue honnête également, avec des arguments précis reposant sur des faits et chiffrés en lieu et place d’opinions.

Parler ensemble de la même chose
Pour soigner la relation, il est ainsi nécessaire de s’obliger à un langage commun, qui peut passer par une définition des termes utilisés. Ainsi, il est manifeste dans certaines publications qu’« Accouchement à domicile » employé de manière générique conduit à l’amalgame de plusieurs situations :
- L’accouchement accompagné à domicile, implicitement par une sage-femme et souvent abrégé en AAD,
- L’accouchement non-assisté, c’est-à-dire en autonomie, abrégé en ANA ou parfois ELA pour Enfantement Libre et Autonomie, qui peut être un choix pleinement souhaité ou une option faute d’alternatives à l’accouchement médicalisé,
- L’accouchement inopiné à la maison, qui n’est pas le projet initial des parents mais arrive trop vite, entraînant l’intervention du SAMU ou des pompiers lui donnant un caractère d’urgence et de danger.
L’AAD, que nous défendons, fait aujourd’hui l’objet de rapports épidémiologiques de la part de l’APAAD, publiés à partir des données collectées par les sage-femmes AAD membres. Ces chiffres, transparents et détaillés, corroborent les résultats de nombreuses parutions scientifiques internationales récentes. Nous recommandons la lecture de la méta-analyse publiée en 2019 par la revue The Lancet pour se faire un avis sur la question. Aucun chiffre à ce jour n’a pu mettre en évidence une morbi-mortalité supérieure dans les pays pour lesquels l’AAD est organisé.
L’AAD est une alternative à l’accouchement médicalisé en structure aujourd’hui plébiscitée par un nombre croissant de femmes : quand seuls 1298 couples ont été accompagnés en 2019, soit 0,14% des naissances, ce sont 17% des femmes âgées de 18 à 45 ans interrogées par l’Ifop en 2021 qui déclarent ‘’tout à fait’’ souhaiter accoucher à domicile, si elles en avaient la possibilité. L’enquête de l’association Make Mothers Matter, réalisée en 2021, également conclut aux mêmes résultats : sur plus de 22000 femmes interrogées, 86% se déclarent en faveur « d’un maximum de choix concernant l’accouchement » dont l’AAD. Ces conclusions sont celles du rapport du Ciane sur la prévention de l’insécurité maternelle qui fait de la diversification des pratiques d’accouchement l’une de ses onze préconisations principales. Enfin, les orientations du Planning Familial pour 2023-2025 incluent elles-aussi l’accès à de meilleures conditions de naissance, dont à domicile.
Des chiffres rassurants d’un côté, une demande croissante de l’autre et des attentes nouvelles concernant l’accouchement en France : que faut-il de plus pour convaincre que l’AAD est un fait de société et doit être pris au sérieux ? Que tant d’associations reconnues dans le milieu de la santé, des droits reproductifs, des droits des femmes arrivent aux mêmes conclusions sans parvenir à obtenir d’effet interroge sur la place ménagée à la parole des usagères…
Interdire au lieu de cadrer met les familles en danger
En pareilles circonstances, l’attitude la plus responsable serait d’utiliser des événements tels que la Semaine de la Sécurité des Patients pour réunir autour de la table des acteurs phares de la périnatalité pour entendre la demande des parents, découvrir les outils dont se sont dotées les sage-femmes AAD et réfléchir à l’établissement d’un cadre sécuritaire d’exercice pour l’ensemble des acteur.rices concerné.es.
Les dépenses publiques pour un tel élargissement de l’offre de soin seraient infimes car elles reposeraient essentiellement sur ce qui existe déjà : des sage-femmes libérales formées, une tarification de l’AGN par la Sécurité Sociale, des services d’urgence et de réanimation. Un effort substantiel consisterait à offrir une assurance dont le montant correspondrait réellement au risque encouru.
Le plus difficile à ce jour reste donc l’objectif même de la Semaine de la Sécurité de Patients : l’établissement de ce dialogue, respectueux, entre les professionnels de différentes disciplines, les professionnels et les patients. L’AAD ne se construit pas contre un système, il doit en faire partie, venir compléter l’offre de soins existante, sans que quiconque se sente dépossédé car il s’agit avant tout pour celles qui enfantent de vivre cette expérience dans leur corps.
Nous entendons les craintes des soignants qui font face à de multiples crises au sein des structures hospitalières. Le manque d’effectifs, des prises en charge rares parfois difficiles face à des drames, la menace du médico-légal peuvent légitimement engendrer un repli sur des protocoles et une routine rassurants. Ceci ne se fait pas au bénéfice des usagers qui, de leur côté, réclament autre chose : moins de soumission à l’autorité médicale, une meilleure prise en compte de choix individuels, un accompagnement personnalisé vécu comme plus humain…
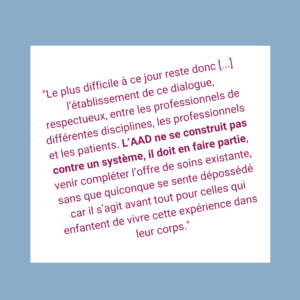 Cependant, personne n’a rien à gagner à s’opposer à l’AAD : ce ne sont pas quelques couples dont la plupart bénéficieront d’un AAD sécuritaire car bien accompagné, qui déstabiliseront tout un système de soins.
Cependant, personne n’a rien à gagner à s’opposer à l’AAD : ce ne sont pas quelques couples dont la plupart bénéficieront d’un AAD sécuritaire car bien accompagné, qui déstabiliseront tout un système de soins.
S’opposer à l’AAD a des répercussions beaucoup plus importantes en termes de santé publique : il est aujourd’hui difficile de quantifier le nombre de couples faisant le choix d’accouchements non-assistés à domicile « par dépit », faute d’avoir accès à une sage-femme. L’accueil réservé aux projets d’AAD au sein des centres hospitaliers ne contribue pas non plus à susciter la confiance des usager.ères et conduit certaines familles à renoncer à un suivi par manque de considération et d’écoute. Nous ne connaissons pas leur nombre mais de telles situations existent aujourd’hui. De nombreux parents viennent à nous, dans le désarroi face à ce qui pour eux est un « non-choix » : pas d’AAD mais pas d’hôpital, les laissant seuls à une décision difficile à prendre.
Cette demande s’inscrit également dans un contexte plus général de réappropriation de leur corps par les individus, enjeu féministe s’exprimant aujourd’hui largement dans toutes les sphères où ce droit est mis en question et dont la grossesse est malheureusement l’un des angles morts. Pourtant, mon corps, mon choix n’a-t-il pas les mêmes raisons d’être dans l’enfantement que dans la lutte pour l’IVG ?
Ainsi, ne pas organiser l’AAD n’empêche pas les femmes d’accoucher où elles le souhaitent. En revanche, ne pas l’organiser les conduira peut-être à enfanter seules, parfois au détriment de leur santé et celle de leur enfant. La morbi-mortalité du manque de réponse a de fortes chances d’être supérieure à celle de l’AAD, qui, elle, est aussi satisfaisante à ce jour que celle des maisons de naissance.
Ainsi, nous souhaitions réaffirmer dans cet article la principale mesure que chacun ait à prendre pour le bien des personnes et de l’AAD : s’efforcer à dialogue à la hauteur des enjeux de la périnatalité, sans préjugés ni mépris de classe, appuyés sur des faits scientifiques et l’expérience des principaux concernés.




